Il reste une soirée à Hervé, quinze ans, pour écrire le poème qui révélera sa gloire -croit-il – au concours « Poésie en liberté ».

Nous retrouvons Hervé dans sa petite chambre de banlieue, les yeux vissés sur son écran d’ordinateur. Au début nous entendons des voix, de ses parents, de Mme Charbonnier, son professeur de français dont il est secrètement amoureux, et de ses camarades qui se moquent de lui. Hervé est un garçon qui nous ressemble, il vit entre ses manques et ses propensions, il est romantique au sens littéraire du terme, il voue une admiration au grands poètes, à ceux qui en avait l’allure aussi comme un Victor Hugo qui écrivait des alexandrins comme il parlait dans sa maison de Guernesey. À partir d’un texte de Rainer Maria Rilke – Lettre à un jeune poète – Hervé doit s’inspirer de son quotidien pour écrire un poème.
Pendant une heure Johann Cuny va interpréter ce jeune Hervé qui essaye par tous les moyens d’écrire son poème passant par internet, le rap ou les vieilles chansons tristes pour lui donner de l’inspiration. Hervé est un jeune inconfortablement installé dans son quotidien, alors comment s’en inspirer ? Lui rêve de grandeur… Et se rêve de façon très narcissique au-dessus des autres ; lui a compris les choses que ces imbéciles de camarades ne soupçonnent même pas.
Johann Cuny en fait un personnage risible et émouvant. L’adolescence est enfin traitée de manière intelligente : Hervé n’est pas le mièvre, l’intello, la racaille, le niais. Non, il est ce que nous avons tous été, des êtres névrosés, tourmentés, parfois un peu trop fiers cachés dans nos chambres et grandis ou écrasés par nos rêves. On reconnait bien le parler de Hervé, son cheveux sur la langue, ses expressions communes ou qui lui sont propres.
C’est un seul en scène drôle, très drôle, et particulièrement émouvant car nous avons de l’empathie pour Hervé. Le jeu de Johann Cuny est génial, très dynamique, on est pris dès les cinq premières minutes avec cette magnifique mise en scène d’Adrienne Ollé !
C’est au Théâtre de la Reine Blanche à Paris, jusqu’au 2 janvier, courez-y !

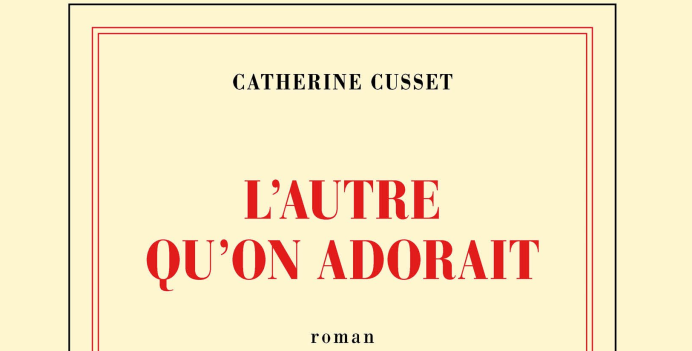 « Phil Miller tapotait le micro, tout le monde s’est tu. Les discours ont commencé. Quand il a prononcé son nom, Nora s’est avancée, les pommettes roses sous les applaudissements. Elle a reçu son prix, accompagné d’un chèque de sept cents dollars qui seraient bien utiles si elles t’accompagnait en France cet été.
« Phil Miller tapotait le micro, tout le monde s’est tu. Les discours ont commencé. Quand il a prononcé son nom, Nora s’est avancée, les pommettes roses sous les applaudissements. Elle a reçu son prix, accompagné d’un chèque de sept cents dollars qui seraient bien utiles si elles t’accompagnait en France cet été. Paul Miller vient de perdre sa femme qui s’est immolée dans leur maison avec leur chien. Paul assiste à la scène, sans pouvoir l’arrêter. C’est après ce drame que nous entrons dans la tête du narrateur.
Paul Miller vient de perdre sa femme qui s’est immolée dans leur maison avec leur chien. Paul assiste à la scène, sans pouvoir l’arrêter. C’est après ce drame que nous entrons dans la tête du narrateur.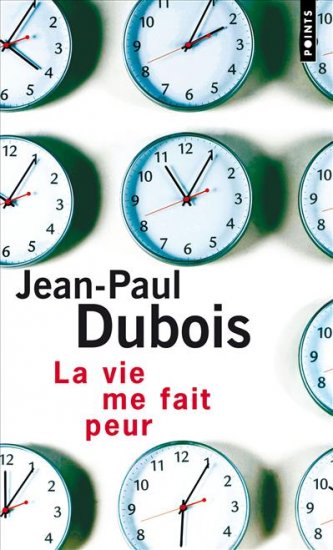 « Bientôt, je m’endormirai avec mes chaussures aux pieds. En avion, je n’ose jamais les enlever. Pour l’instant, je regarde rapetisser le monde à travers le hublot. A cette distance, les contours brumeux de la ville prise dans le froid évoquent la forme fumante d’un gros animal couché sur la neige. On le dirait peint pour la chambre d’un malade. »
« Bientôt, je m’endormirai avec mes chaussures aux pieds. En avion, je n’ose jamais les enlever. Pour l’instant, je regarde rapetisser le monde à travers le hublot. A cette distance, les contours brumeux de la ville prise dans le froid évoquent la forme fumante d’un gros animal couché sur la neige. On le dirait peint pour la chambre d’un malade. » « Couple flânant sur le quai Saint-Michel, bras dessus, bras dessous. Je les dépasse, je ralentis, j’entends l’homme dire : « Et quand tu ne digères pas une addition, tu ressembles à ta mère. »
« Couple flânant sur le quai Saint-Michel, bras dessus, bras dessous. Je les dépasse, je ralentis, j’entends l’homme dire : « Et quand tu ne digères pas une addition, tu ressembles à ta mère. »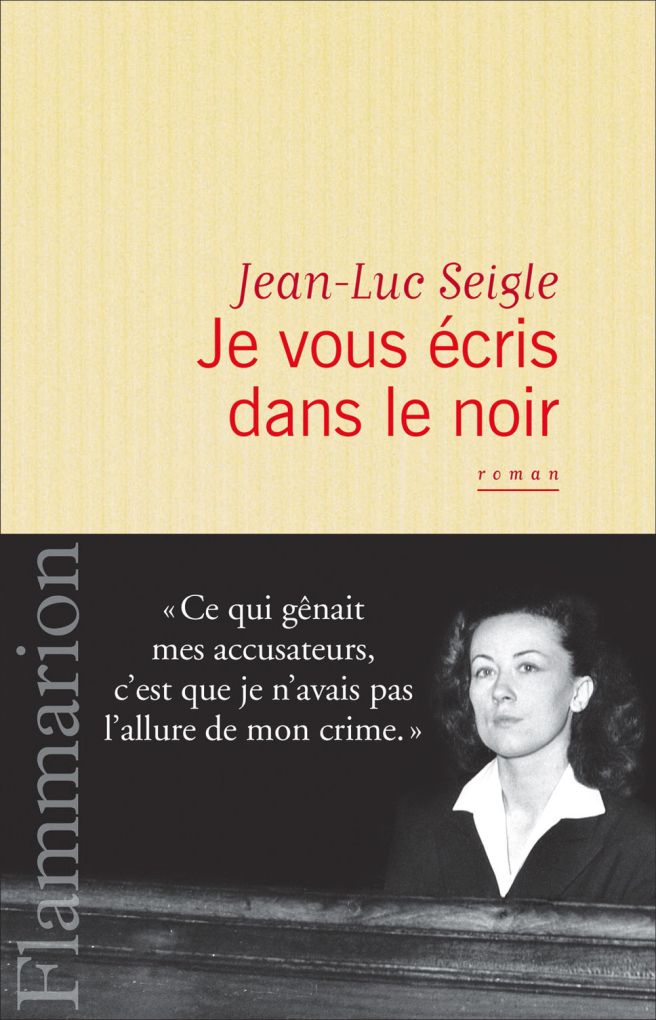
 se Lydie Salvayre : celle de Bernanos désespérément révolté qui assista incrédule à la guerre espagnole et celle de Montse, la mère de la narratrice, qui a enfoui au plus profond d’elle les souvenirs de cette période à cause de la maladie d’Alzheimer. Sa fille, va tenter de faire rejaillir les souvenirs de sa jeunesse. Et c’est une Montse qui n’avait peur de rien, que l’on retrouve, qui suivait à Lerrida son frère Josep, porté lui, par ses idées libertaires.
se Lydie Salvayre : celle de Bernanos désespérément révolté qui assista incrédule à la guerre espagnole et celle de Montse, la mère de la narratrice, qui a enfoui au plus profond d’elle les souvenirs de cette période à cause de la maladie d’Alzheimer. Sa fille, va tenter de faire rejaillir les souvenirs de sa jeunesse. Et c’est une Montse qui n’avait peur de rien, que l’on retrouve, qui suivait à Lerrida son frère Josep, porté lui, par ses idées libertaires.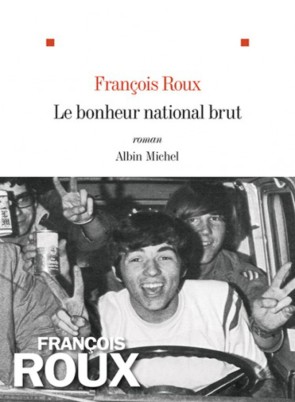 « Le pays était bel et bien coupé en deux.
« Le pays était bel et bien coupé en deux. Ce livre court, publié en 1995, présente les figures féminines de Charles Juliet. Il retrace la vie des deux mères de l’auteur : celle qui lui a donné la vie et celle qui l’a élevé, ainsi que la vie de l’auteur. La première, paysanne, est décédée lorsqu’il était en bas âge, elle souffrait de dépression et n’avait jamais pu, elle qui était passionnée de français et de mots, exprimer ses ambitions littéraires et scolaires. Elle arrêta sa scolarité à la fin de l’école élémentaire pour s’occuper de la vie de la ferme. Plus tard elle se maria et eut de nombreuses grossesses. La deuxième, paysanne aussi, a accepté d’accueillir l’enfant au sein du foyer et l’a élevé comme ses autres enfants. Enfin, la vie de l’auteur, souvent parsemée de pensées sombres mais qui finit sur une note d’espoir :
Ce livre court, publié en 1995, présente les figures féminines de Charles Juliet. Il retrace la vie des deux mères de l’auteur : celle qui lui a donné la vie et celle qui l’a élevé, ainsi que la vie de l’auteur. La première, paysanne, est décédée lorsqu’il était en bas âge, elle souffrait de dépression et n’avait jamais pu, elle qui était passionnée de français et de mots, exprimer ses ambitions littéraires et scolaires. Elle arrêta sa scolarité à la fin de l’école élémentaire pour s’occuper de la vie de la ferme. Plus tard elle se maria et eut de nombreuses grossesses. La deuxième, paysanne aussi, a accepté d’accueillir l’enfant au sein du foyer et l’a élevé comme ses autres enfants. Enfin, la vie de l’auteur, souvent parsemée de pensées sombres mais qui finit sur une note d’espoir :